
L’emprise de la novlangue
Analyser notre société en l’attrapant par la langue, c’est l’entreprise à laquelle s’est livré l’économiste Jean-Paul Fitoussi dans Comme on nous parle. L’emprise de la novlangue sur nos sociétés. Un essai paru en 2020 et toujours d’actualité, dont voici quelques éléments.
Par Jacques Vassevière, professeur de lettres
Analyser notre société en l’attrapant par la langue, c’est l’entreprise à laquelle s’est livré l’économiste Jean-Paul Fitoussi dans Comme on nous parle. L’emprise de la novlangue sur nos sociétés. Un essai paru en 2020 et toujours d’actualité, dont voici quelques éléments.
Par Jacques Vassevière, professeur de lettres
Comme on nous parle, l’essai publié par Jean-Paul Fitoussi en 2020 sur la novlangue, est une « entreprise […] de déconstruction du discours officiel » (p. 103). L’économiste analyse notre société par le biais de la langue qui y circule et la conforte. Une langue au dictionnaire appauvri, une novlangue orwellienne qui, comme dans 1984, mais sans coercition, « sans offenser ni contrarier quiconque » (p. 36), « permet de faire converger les pensées » (p. 5) dans une pensée unique.
Ce discours creux, pauvre, simplificateur, dans lequel la communication et la propagande prennent le pas sur l’information, c’est « la langue du pouvoir »(p. 129), reprise par certains médias, surtout audiovisuels.
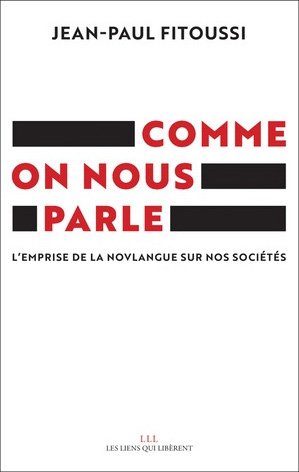
Le cadre idéologique de la novlangue
« L’appauvrissement du langage […] réduit le champ des solutions et fait apparaître la vie telle qu’elle est comme finalement pas si mal. Il produit ainsi de la résignation, qui pousse à accepter son sort », écrit Jean-Paul Fitoussi (p. 13) en dessinant le cadre d’un libéralisme économique qui ne voit de salut que dans le libre fonctionnement des marchés. S’opposant à ce discours des écoles économiques néoclassiques, l’auteur se réclame de la théorie keynésienne, « dernier état de l’économie politique, le seul à pouvoir expliquer (imparfaitement, bien sûr) le monde »(p. 9).
Au lieu de faire des choix dans l’intérêt de la population, les pouvoirs en place, comme si l’économie était mécanique, suivent des « règles idéologiques ou doctrinales » (budgétaires, européennes) qui conduisent à « réduire le poids du politique et son emprise sur l’économie » (p. 29) : ils ont perdu leur souveraineté budgétaire. Et Jean-Paul Fitoussi de développer une analyse sans concession qui entend « montrer […] à quel point l’évolution de la langue a contribué à appauvrir notre perception de la réalité et à nous autolimiter dans les actions que nous pouvions entreprendre. Nous, c’est-à-dire ceux qui nous gouvernent » (p. 184).
Cette novlangue fait disparaître des mots, en valorise ou en discrédite d’autres en leur attachant des connotations trompeuses. Elle dit pour ne pas dire ou pour dire autre chose que ce qu’elle dit littéralement. C’est cet aspect du livre qui est le plus intéressant. Voici quelques-uns des éléments de langage (« langage de faux-culs », p. 23) de la théorie du libéralisme économique.
Dictionnaire (critique) de la novlangue :
Chômage de masse. Qualifié d’inacceptable dans la novlangue, il est pourtant accepté en Europe depuis cinquante ans. Les gouvernements ne font pas du plein-emploi un objectif prioritaire, accessible ; pour réduire le chômage, ils prônent des réformes structurelles augmentant la précarité de l’emploi (pp. 42-44).
Chômage des jeunes. Un désastre, dont est en grande partie responsable la novlangue qui donne aux politiques d’austérité un fondement éthique (p. 150).
Compétitivité. Un des commandements de la novlangue. « La novlangue nous dit compétitivité, mais il faut entendre précarité », car cette compétitivité est recherchée par la réduction de la protection sociale et de la protection du travail (p. 159).
Concurrence. Rappelons d’abord que le traité de Lisbonne (2007) stipule que « la concurrence est libre » et prévoit« un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée ».Jean-Paul Fitoussi l’accuse de « faire obstacle aux politiques industrielles conduites par les États de l’Union » (p. 130). « L’essentiel des problèmes européens provient de la concurrence fiscale et sociale »; « la concurrence fiscale contribue à redistribuer les revenus des salaires vers les profits »(pp. 155-157).
Concurrence et Rente. Valorisée en raison de son efficacité, de ses avantages pour le consommateur, la concurrence est en fait réduite à peu de choses dans un marché dominé par des oligopoles et des quasi-monopoles qui cherchent à maintenir ou accroître les profits qu’ils tirent de leur position dominante: « On vous dit concurrence, mais il faut entendre rente ». Mais, dans la novlangue, « les vrais rentiers ne sont pas les entreprises géantes, ni les hyperpuissances, mais les gens qui demandent abusivement à être protégés, cherchant ainsi à échapper aux dures réalités de la concurrence – les cheminots, les fonctionnaires et, plus généralement, les salariés dépendants » (pp. 20-21).
Dette publique. Pour la novlangue, c’est une faute(p. 66) ; pour Jean-Paul Fitoussi, c’est un moyen au service de la politique économique. La peur de l’endettement de l’État relève du fantasme puisque, contrairement à une personne, il peut toujours rembourser en s’endettant de nouveau. Le problème est que l’Union européenne et les États qui la composent ont perdu leur souveraineté monétaire : « L’Europe est sans conteste sous la tutelle sévère et des marchés, et de certains États » (pp. 120-121). Jusqu’à la tragédie du coronavirus, ses membres devaient aussi respecter l’orthodoxie budgétaire ; ils s’en sont affranchis (provisoirement ?) en adoptant un plan de relance mutualisant la dette européenne (p. 108).
Dévaluation. Considérée comme une faiblesse alors que dans certains pays « la dévaluation compétitive mettrait fin (sur le long terme et après de graves secousses) à leur déficit et par là même à leur dette extérieure » (pp. 66 et 106).
Élites. La novlangue libérale est parlée par des « élites », définies comme telles non en fonction de leur mérite réel, mais des positions qu’elles occupent. L’auteur les qualifie de « populistes » et de « démagogues »puisqu’elles promettent le bonheur par l’effet des forces du marché, de la globalisation, du ruissellement au moment où s’accroissent les inégalités (pp. 16-17).
Exploitation. Mot quasiment effacé des livres d’histoire par la novlangue (p. 80).
Fin du travail. « Illusion convoquée par la novlangue pour parfaire son entreprise de démoralisation des salariés »et leur faire accepter « toujours plus de précarité, toujours plus d’insécurité ». « La gig économie [l’économie des petits boulots] est-elle notre avenir ? » (pp. 71-80).
Inflation. Dans la novlangue, c’est une menace, alors qu’elle serait utile (elle l’a été dans le passé) pour redresser des économies endettées. « Le risque aujourd’hui est plutôt celui d’une déflation » (p. 124).
Keynésien. Adjectif péjoratif, archaïque, en voie de disparition.
Mérite. La novlangue justifie et favorise l’accroissement des inégalités par « le rôle éminent de la méritocratie dans le capitalisme : votre bonne fortune ne tient qu’à votre mérite », et non aux diverses rentes que vous avez accumulées ou à la chance (p. 29).
Plein emploi. Expression tombée en désuétude : la novlangue veut nous persuader que le plein-emploi est « impossible, utopique » (p. 80).
Politique budgétaire expansionniste. Expression bannie de la novlangue qui ne connaît que les politiques budgétaires restrictives : pacte de stabilité, équilibre budgétaire. Ainsi en 2009, « en pleine récession, entre l’emploi, la croissance et l’équilibre budgétaire, on a choisi l’équilibre budgétaire, l’exact opposé de ce qu’il aurait fallu faire » (p. 117).La crise sanitaire actuelle a toutefois imposé une inversion des priorités en privilégiant le bien-être de la population. Ce changement de doctrine sera-t-il durable ? (p. 116).
Réforme structurelle. Expression emblématique de la novlangue qui ne signifie rien d’intelligible. Les réformes structurelles des Thatcher, Reagan, Schröder, Monti ont constitué des régressions sociales : transfert du pouvoir de négociation des salariés vers les entreprises, réduction de la protection sociale et de la part des pensions dans le PIB (pp. 38-40).
Règles et Choix. Les « règles de langage » (politiquement correctes) et les « règles de gouvernement » (notamment les règles budgétaires européennes, qui mettent les pays sous la tutelle des marchés) imposent l’idée qu’il n’y a pas d’alternative : on n’aurait plus le choix. Les gouvernants ne gouvernent pas, ils ne font que « commenter, […] expliquer en novlangue leur volonté de ne pas agir ou leur impossibilité de le faire » (pp. 23-27).
Ressources humaines.« Nous avons élevé les directions du personnel au rang de directions des ressources humaines. Cette évolution du langage n’est pas anodine. Lorsque les personnes deviennent ressources (comme les ressources pétrolières, par exemple), le travail devient plus que jamais marchandise » (p. 78).
Souveraineté (« encore un mot que la novlangue s’emploie à redigérer »: « souverainiste » est péjoratif). Les souverainetés nationales, mises à mal par la division internationale du travail, comme l’a montré pendant la pandémie la pénurie de certains biens essentiels à la protection des citoyens, devraient être rétablies pour permettre aux pays qui le souhaitent de mener une politique de protection sociale et d’investissement.
Unanimité dans les décisions européennes. Formulation en novlangue d’un droit de véto dont dispose chaque pays membre de l’Union européenne et qui rend impossible ou difficile la solidarité entre ces États.
Union européenne. Ce serait une « fédération d’États-nations » selon une appellation (« summum de la novlangue » – p. 132) qui réunit des contraires. En réalité, cette « Europe des contraintes et des nations » (p. 110) fait obstacle à une véritable construction européenne. Elle impose une seule ligne, une « réforme structurelle » qui ne bénéficie qu’aux entreprises et maintient un chômage de masse. La crise grecque a montré que « l’Europe était une “union” où le fort l’emportait toujours sur le faible » : « il est grand temps de réformer structurellement l’Europe » mais la novlangue appose « l’étiquette infamante d’anti-européen »à ceux qui l’envisagent (pp. 118-119). « Le désamour de l’Europe que l’on voit grossir élection après élection se nourrit de ce renoncement au progrès que paraît exiger la construction européenne »(p. 187).
Le risque d’un régime autocratique
Cet essai décrit ce qu’on pourrait appeler, en référence à l’ouvrage de l’historien François Furet, «le présent d’une illusion», mais il s’agit cette fois d’une autre idéologie : le libéralisme économique. Bien qu’elle ne permette pas de réduire le chômage de masse, qu’elle inspire des « réformes structurelles » qui accroissent la précarité et dégradent la qualité de vie, l’emprise de la novlangue fait qu’elle reste bien présente, efficiente.
Jean-Paul Fitoussi prend parti : il s’étonne, s’indigne, s’inquiète aussi car ce dogmatisme doctrinal est dangereux. Il faut sortir de « cette logique binaire qui accroît partout la violence des controverses politiques » (p. 166), suscite dans la population le désenchantement, la défiance vis-à-vis des partis de gouvernement, fait le jeu des populistes et des partis extrémistes et risque de conduire à l’instauration d’un régime « illibéral ». « Nous pourrions bien nous retrouver dans un régime politique autre qu’une démocratie […] parce que l’on poursuit des objectifs qui ne sont pas ceux de la démocratie – équilibre budgétaire et compétitivité plutôt que plein emploi et bien-être. »(p. 63) Il faut ainsi « une autre politique »(expression qui a aussi disparu du dictionnaire de la novlangue) et une autre langue : « la novlangue de la mondialisation heureuse a prouvé qu’elle n’était plus crédible » (pp. 172-173).
Il est difficile de ne pas partager ses craintes… et ses espoirs.
J. V.
Jean-Paul Fitoussi, Comme on nous parle. L’emprise de la novlangue sur nos sociétés, Les Liens qui Libèrent, 2020, 190 pages, 17,50 euros.
