Toutes les vies d’Aharon Appelfeld

S’il fallait choisir un repère dans notre découverte d’Aharon Appelfeld, ce serait l’année 2004. Une jeune traductrice, également romancière qui publie à l’École des loisirs et à l’Olivier, le fait connaître, décide de donner toute son œuvre en français. C’est Valérie Zenatti. Alors paraît Histoire d’une vie, mémoires de l’écrivain, qui le révèle au public et reçoit le Prix Médicis.
Jusque là, peu de lecteurs l’avaient lu et ses romans paraissaient chez divers éditeurs, sans la continuité qui s’impose. Rendons hommage à Arlette Pierrot et Sylvie Cohen, ses traductrices ; elles savaient quelle importance était la sienne. Primo Levi appréciait sa « voix unique, inimitable. D’une éloquence toute en retenue » et dans Parlons travail, comme dans Opération Shylock, Philip Roth donne à entendre cette voix à travers des entretiens passionnants.
Mais à partir de Histoire d’une vie, nous avons pris rendez-vous avec lui, et même s’il ne sera plus là pour nous parler de son dernier roman traduit, nous lirons en février Des jours d’une stupéfiante clarté.
Les vies d’Aharon Appelfeld
Aharon Appelfeld a eu au moins deux vies. La première s’est déroulée en Bucovine, avant 1945, la seconde en Israël, où il est arrivé adolescent, en 1946, deux ans avant que ce pays ne devienne indépendant. On pourrait ajouter à ces vies réelles des vies fictives puisque Hugo, dans La Chambre de Mariana, Erwin, dans Le garçon qui voulait dormir, Michaël alias Janek dans De longues nuits d’été, Adam et Thomas, les deux héros du roman qui porte ce titre sont autant d’incarnations du jeune Aharon que l’on suit dans son récit autobiographique.
 Adam et Thomas sont emblématiques. Ils représentent la dualité de cet homme. Adam vit caché en hauteur, dans un arbre, pouvant voir ce qui se passe, un peu à l’écart de la menace ou du danger. Il est agile, proche du concret, cueille des fruits pour se nourrir. Thomas est un bon élève, myope, pas très habile dans la nature. Aharon Appelfeld concilie (je préfère garder le présent) ces deux personnalités.
Adam et Thomas sont emblématiques. Ils représentent la dualité de cet homme. Adam vit caché en hauteur, dans un arbre, pouvant voir ce qui se passe, un peu à l’écart de la menace ou du danger. Il est agile, proche du concret, cueille des fruits pour se nourrir. Thomas est un bon élève, myope, pas très habile dans la nature. Aharon Appelfeld concilie (je préfère garder le présent) ces deux personnalités.
De son enfance, il conserve le goût de la nature, celui des animaux, une forme de sensualité que le lien avec sa mère développe. À le lire, on sent le bonheur qu’il a connu auprès de ses parents, dans un foyer de la bourgeoisie juive assimilée, qui s’éloignait du divin et du rite. Son enfance, ce sont aussi les membres de la famille que tout oppose, certains engagés dans le mouvement communiste, d’autres poursuivant une existence oisive de dandies. Ce sont les vacances dans d’élégantes stations thermales. On y parle de tout et de rien, beaucoup, on commente les rumeurs, et l’enfant fait tout pour échapper à cette communauté, qu’il retrouvera l’année suivante.
L’enfance à Czernowitz, ce sont les langues, nombreuses dans ces terres de confins : le ruthène parlé par sa nourrice (ou par des servantes de ses romans), le yiddish, le polonais, le roumain, l’ukrainien appris pendant la guerre, le russe des libérateurs soviétiques, et bien sûr l’allemand, sa langue maternelle. Dans ses romans, celui ou celle qui représente la tradition juive est paradoxalement un ou une non juive. Le plus fidèle serviteur du grand-père, incarnation de ce judaïsme religieux, c’est Sergueï, dans De longues nuits d’été, ou Maria, servante ruthène travaillant chez Saltzer dans Les Eaux tumultueuses.
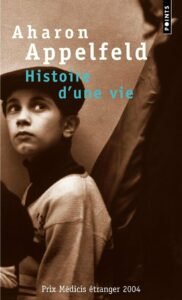 L’univers d’Appelfeld n’est pas univoque, au contraire : « Je préfère la forêt au champ ouvert […], le porteur d’une tare aux hommes sains, les hommes chassés de leur village aux soit-disant honnêtes propriétaires. » Ce propos, il le tient dans Histoire d’une vie et tout ce qu’il écrit en est l’illustration. Mariana, qui le cache au péril de sa vie dans un réduit, est une prostituée. La plupart du temps, l’enfant voit ou entend ce qui se passe dans la pièce où elle reçoit. Dès que le danger s’éloigne, il la rejoint, dort près d’elle ; elle apaise ses craintes. On trouverait dans maints romans des personnages comme elle, pas forcément bien vus des bonnes gens, mais des sauveurs. Quand le danger est trop grand, et qu’il ne sait quoi faire, elle le tranquillise : « Fais comme si tu n’existais pas. »
L’univers d’Appelfeld n’est pas univoque, au contraire : « Je préfère la forêt au champ ouvert […], le porteur d’une tare aux hommes sains, les hommes chassés de leur village aux soit-disant honnêtes propriétaires. » Ce propos, il le tient dans Histoire d’une vie et tout ce qu’il écrit en est l’illustration. Mariana, qui le cache au péril de sa vie dans un réduit, est une prostituée. La plupart du temps, l’enfant voit ou entend ce qui se passe dans la pièce où elle reçoit. Dès que le danger s’éloigne, il la rejoint, dort près d’elle ; elle apaise ses craintes. On trouverait dans maints romans des personnages comme elle, pas forcément bien vus des bonnes gens, mais des sauveurs. Quand le danger est trop grand, et qu’il ne sait quoi faire, elle le tranquillise : « Fais comme si tu n’existais pas. »
La forêt et le rêve
Les personnages d’Appelfeld ont différentes façons de faire comme s’ils n’existaient pas. D’abord ils observent et se taisent. Ils gardent leurs distances, un peu comme le fait le baron perché, du roman de Calvino. Cette hauteur, Appelfeld la conservera toute sa vie. Il ne se mêle pas à la vie politique israélienne, pourtant si prompte à vous happer. Il n’écrit pas sur son pays comme si l’enfance restait le seul et vrai pays. Et dans ce pays, la forêt.
Elle est le royaume, parfois lieu maléfique, souvent sanctuaire. C’est le lieu par excellence des romans, ce qui les rapproche des contes. On y fait des rencontres, parfois inquiétantes, souvent surnaturelles, comme celle de Mina, « petite fille d’un autre monde » semblable à un ange dans Adam et Thomas. On y connaît la menace, la peur ; c’est le lieu des massacres qu’Appelfeld ne décrit que de façon elliptique. Mais on n’y « existe pas », juché au sommet d’un arbre, ou caché par des brigands peu recommandables.
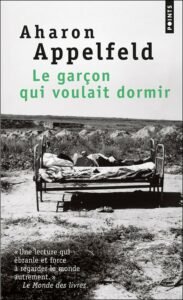 L’autre lieu d’invisibilité est le sommeil, et le rêve. Erwin, le garçon qui voulait dormir, incarne Appelfeld quittant l’Europe, la langue maternelle, pour une terre qui aime les héros. La langue qu’on lui inculque, plutôt qu’on ne la lui enseigne, est remplie de mots d’ordre, de slogans : il faut « porter le futur aux nues ». Vieux programme que l’adolescent n’entend guère. Alors il dort, il rêve et il se tait. Il dialogue avec ses disparus, renoue avec les sensations fugaces qui l’ont rendu heureux, dans la maison familiale :
L’autre lieu d’invisibilité est le sommeil, et le rêve. Erwin, le garçon qui voulait dormir, incarne Appelfeld quittant l’Europe, la langue maternelle, pour une terre qui aime les héros. La langue qu’on lui inculque, plutôt qu’on ne la lui enseigne, est remplie de mots d’ordre, de slogans : il faut « porter le futur aux nues ». Vieux programme que l’adolescent n’entend guère. Alors il dort, il rêve et il se tait. Il dialogue avec ses disparus, renoue avec les sensations fugaces qui l’ont rendu heureux, dans la maison familiale :
« Avec le temps, je compris que cette contemplation intérieure était une manière de puiser dans mon âme des scènes qui avaient sombré depuis des années et qui miraculeusement, en remontant à la surface, réapparaissaient intactes ».
La langue et l’ironie
L’apprentissage de l’hébreu, celui qu’il choisit de faire chaque nuit après le travail des champs, commence avec la copie de versets bibliques, cette « langue âpre et silencieuse des montagnes ». Il aime son austérité : « La langue hébraïque m’a appris à penser, à être économe de mes mots, à ne pas me répandre en adjectifs, ne pas trop intervenir, ne pas trop interpréter », confie-t-il ainsi à Philip Roth dans Parlons travail.
Dans la fiction, Sergueï, le vagabond qui protège et accompagne Michaël, respecte cette éthique de la langue :
« Quand il veut qualifier quelque chose qu’il ne faut pas faire, il utilise l’adjectif “laid”. Quand il s’agit d’un acte qui cause du tort il utilise l’adjectif “méprisable” et pour un acte cruel il dit “ignoble”. »
Cet hébreu si limpide, si aérien, est ce qui distingue Appelfeld. Il est lecteur d’Agnon, originaire de Galicie, Prix Nobel en 1966 et écrivain israélien comme lui. Il apprend de ce maître que l’on peut emporter sa ville natale partout et y vivre pleinement. Mais sa pratique de l’hébreu n’est pas très éloignée de celle que Kafka avait de l’allemand : rester précis et clair, ne jamais trop en dire pour laisser au lecteur le soin de comprendre et de s’approprier la fable. Il faut laisser une place à l’ironie, procédé majeur du roman, voire morale de ce genre qui refuse de prendre parti ou de juger.
 Mais l’essentiel, dans sa lecture de Kafka, tient à l’absurde, comme il l’explique à Roth :
Mais l’essentiel, dans sa lecture de Kafka, tient à l’absurde, comme il l’explique à Roth :
« À ma grande surprise, non seulement il me parlait ma langue maternelle, mais aussi un idiome familier, le langage de l’absurde. Je savais de quoi il parlait. Cela n’avait rien d’une langue ésotérique pour moi, je n’avais nul besoin d’explications. Moi, je venais des camps et des forêts, d’un monde à l’image même de l’absurde où rien ne m’était étranger. Ce qui me sidérait, c’était que cet homme qui n’y avait jamais mis les pieds le connaisse si bien, et en détail. »
Appelfeld met en scène des êtres qui doutent, qui bégaient, ne trouvent pas leurs mots. Et des êtres qui s’affirment, qui marchent, des êtres aussi déterminés que les personnages de contes qui fuient l’adversité, et semblent n’avoir peur de rien.
Appelfeld est celui qui commence ainsi Adam et Thomas : « Ils marchaient main dans la main, rapidement. Ils arrivèrent à la lisière de la forêt avec le lever du jour. »
La nuit est tombée avec sa disparition, mais le lire amène le jour.
Norbert Czarny
.

© l’école des loisirs, 2014
Voir sur ce site :
• Aharon Appelfeld, « Adam et Thomas », traduit par Valérie Zenatti, illustré par Philippe Dumas, par Norbert Czarny.
• Entretien avec Aharon Appelfeld à propos de son premier livre pour la jeunesse, « Adam et Thomas », par Valérie Zenatti.
• Le roman des ressemblances : « Le garçon qui voulait dormir », d’Aharon Appelfeld, traduit par Valérie Zenatti, par Norbert Czarny.
• « Mensonges », de Valérie Zenatti. Un exercice d’admiration, par Norbert Czarny.
Sur France Culture :
• Aharon Appelfeld : « L’écrivain qui m’est le plus proche, qui me parle le plus intimement, est jusqu’à aujourd’hui Franz Kafka ». Entretien avec Laure Adler en 2013 :
« La bande de criminels qui m’a recueilli dans la forêt [ à l’âge de dix ans, alors qu’il venait de s’échapper d’un camp où il avait été déporté, en Ukraine, en 1941 et où il restera caché durant trois ans] était constituée de gens qui n’étaient pas des gens faciles. On peut dire qu’ils étaient violents et se comportaient avec violence à mon égard. Mais c’est chez eux, auprès d’eux, que j’ai réussi à protéger l’enfant qui est en moi, cet enfant qui avait gardé un immense espoir : que cette vie de criminel n’était que temporaire. Et qu’après la guerre, je deviendrai ce que mes parents avaient espéré que je sois, c’est-à-dire un intellectuel européen. […] Sans le savoir, les voyous avec lesquels j’étais m’ont inculqué les prémices de ce que peuvent être des règles d’écriture : ne parle pas lorsque le besoin ne s’en fait pas ressentir, ne dis que des choses de façon brève et concise, tais-toi lorsqu’il n’y a pas lieu de parler… Et ils se comportaient comme ça. Ils appliquaient eux-mêmes ces règles et sans le savoir j’ai accueilli en moi cette graine qui a poussé ensuite et qui m’a servi au moment où moi-même j’ai commencé à écrire. »
• Voir sur ce site : « Aharon Appelfeld, le kaddish des orphelins », documentaire d’Arnaud Sauli, par Antony Soron.
