
Villiers de l’Isle-Adam,
prophète de la dépoétisation
du monde
Par Pascal Caglar, professeur de lettres (académie de Paris)
Auteur de la fin du XIXe siècle, secondaire en son temps, mais de premier rang maintenant, l’auteur des Contes cruels est un des critiques les plus ironiques de la dépoétisation du monde, profané par le progrès scientifique et le développement économique. Ses satires recourent à une forme brève et percutante : la nouvelle.
Par Pascal Caglar, professeur de lettres (académie de Paris)
Lorsque, dans les programmes de troisième du cycle 4 et au-delà, le thème du monde (« regarder le monde, découvrir le monde ») rencontre la question des « rêves et progrès scientifiques », un écrivain s’impose comme le témoin et juge des évolutions modernes : Villiers de l’Isle-Adam.
Auteur de la fin du XIXe siècle, secondaire en son temps, mais de premier rang maintenant, Villiers est un des critiques les plus ironiques de la dépoétisation du monde, profané par l’action conjuguée du progrès scientifique et du développement économique. Ses satires sont d’autant plus vives qu’elles recourent en majorité à une forme brève et percutante : la nouvelle. Son principal recueil, Contes cruels (1883), augmenté de Nouveaux Contes cruels (1888), est effectivement très violent pour la société bourgeoise de son temps, stigmatisée pour sa conversion sans scrupule au culte de l’argent et du progrès. Dans « L’Affichage céleste », nouvelle d’abord publiée dans la presse en 1873, Villiers prophétise une prochaine exploitation commerciale du ciel mettant fin à des siècles de rêveries poético-religieuse.
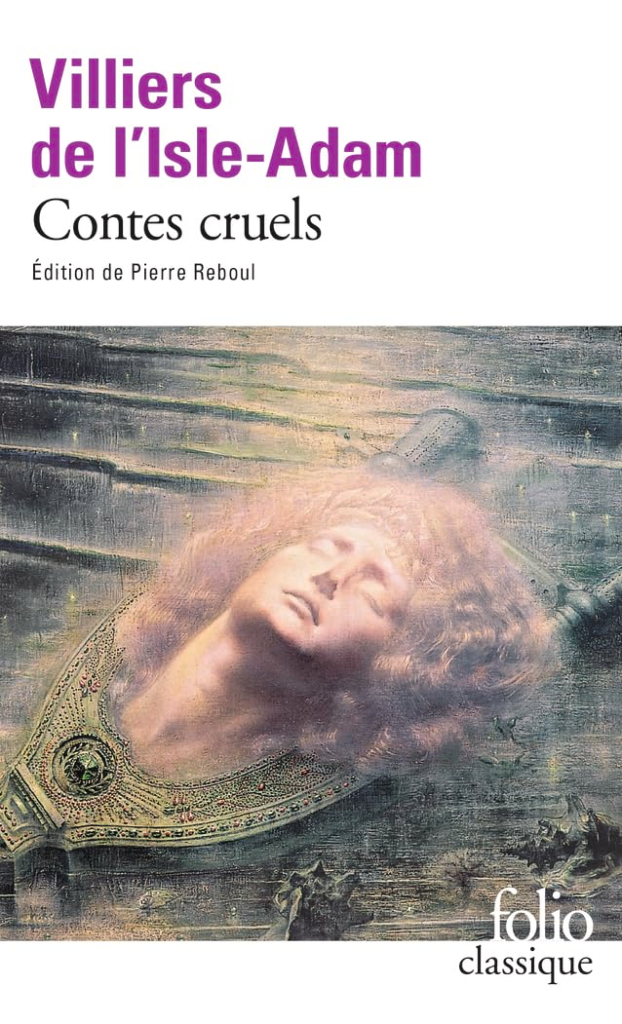
Qui n’a pas rêvé devant un ciel nocturne constellé d’étoiles lointaines et scintillantes ? Ce rêve saisissant l’imagination, suscitant l’émerveillement, suggérant une existence divine, ce rêve poétique qui inspira les Hymnes de Ronsard ou les Méditations poétiques de Lamartine, Villiers, amer et ironique, constate sa transformation en un rêve matérialiste. Un rêve d’exploitation et de rentabilisation du ciel grâce aux progrès de la science, à l’électricité nouvelle et aux techniques de réflecteurs lumineux. Cruauté du conte : passer du rêve poétique au rêve scientifique n’est pas pour Villiers un progrès pour l’homme, mais une déchéance cuisante, non pas une augmentation d’être mais un appauvrissement d’âme, et cette dégradation se voit alors dénoncée d’un bout à l’autre d’un récit ironique prétendant saluer l’invention d’un savant, le professeur Grave, sa prouesse technique révolutionnaire, capable de transformer le ciel en panneau publicitaire géant.
Nul meilleur exercice de déchiffrement d’antiphrases que de faire relire aux élèves les pages évoquant les publicités projetées dans la nuit, lorsque, par exemple, Villiers, ironique, écrit : « À quoi bon ces voûtes azurées qui ne servent à rien ? », ou encore « Défricher l’azur, exploiter les deux crépuscules, mettre à profit le firmament, quel rêve ! » et plus féroce encore son jugement du public faussement admiratif : « on s’assoit sous la treille pour mieux goûter ce spectacle à la fois magnifique et instructif […] Quel émoi… si on apercevait un petit papier sur lequel on lirait ces mots : Dieu que c’est bon ! ». Tout est à l’avenant. Non seulement Villiers cache son indignation derrière l’ironie, mais il se montre aussi visionnaire, prophète d’un avenir d’apparence enthousiasmant mais réellement lamentable : celui d’une publicité devenue nouveau spectacle pour tous, captivant les foules et uniformisant les conditions, empêchant tout regard esthétique sur le ciel, les étoiles et leurs constellations. Villiers comprend et exhibe les ressorts d’une publicité proche de la propagande : toucher le plus grand nombre, la masse sans culture, utiliser le langage de l’image, des figures suggérées par les astres, rechercher les raccourcis de l’irrationnel : le mot d’esprit, le slogan.
Villiers va même plus loin : il feint de voir des avantages de toutes sortes dans l’exploitation publicitaire du ciel : avantages en premier lieu pour les industriels qui en retireront des bénéfices commerciaux considérables ; pour la police ensuite qui, selon lui, pourrait projeter dans le ciel les portraits des criminels et autres malfaiteurs ardemment recherchés ; pour les politiques enfin, qui pourraient, lors d’élections par exemple, rayonner au-dessus de nos têtes et associer leur nom à telle ou telle étoile ou constellation (Villiers, toujours ironique, associant Messieurs A et B à l’étoile Béta de la constellation de la Lyre !).
Après ce tableau d’une nouvelle ère de prospérité, le conte s’achève sur un hymne au progrès entendu comme la capacité de l’homme à convertir toute parcelle du monde en espace rentable et productif, en l’occurrence « à élever le ciel à la hauteur de l’époque ». Ce qui, sans ironie, veut dire abaisser le ciel comme jamais il le fut, tomber bien bas dans les ambitions de l’humanité.
Villiers prend acte d’un monde qui finit, un monde encore imprégné de culture, de mythologie, de poésie, de religion, de sacré, et qui cède la place au monde dit positiviste, industriel et scientifique, un monde de l’usage et de la valeur marchande. C’est la fin d’un mouvement qui, tout au long du XIXe siècle, commençant avec Kant qui définissait le goût, c’est-à-dire le sens du beau, comme un mouvement désintéressé (sans finalité, sans justification conceptuelle), et pourtant nécessaire, reconnu par tous (universel), s’est poursuivi avec les Romantiques puis les Parnassiens. Ceux-ci, derrière Gauthier, ont repris ce crédo : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien : tout ce qui est utile est laid. » Villiers est le dernier résistant à un monde confondant bientôt beauté et plaisir des sens, bonheur et consommation, profit et valeur.
La littérature la plus fantaisiste est parfois toute proche de la réalité : ce ciel profané, désacralisé, menacé d’exploitation publicitaire n’est plus aujourd’hui de la science-fiction, l’imagination dystopique d’un rétrograde comme Villiers, mais un avenir sérieusement envisagé par différentes sociétés russes, canadiennes ou américaines qui travaillent toutes à un nouvel « affichage céleste » au moyen de satellites et autres technologies numériques aux résultats encore expérimentaux.
Ce qu’il y a à craindre, ce n’est pas que le texte de Villiers ait perdu de son actualité mais qu’il ait perdu de sa force critique : que les jeunes lecteurs d’aujourd’hui s’émerveillent davantage des promesses techniques que des promesses de la nature.
P. C.
L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.
